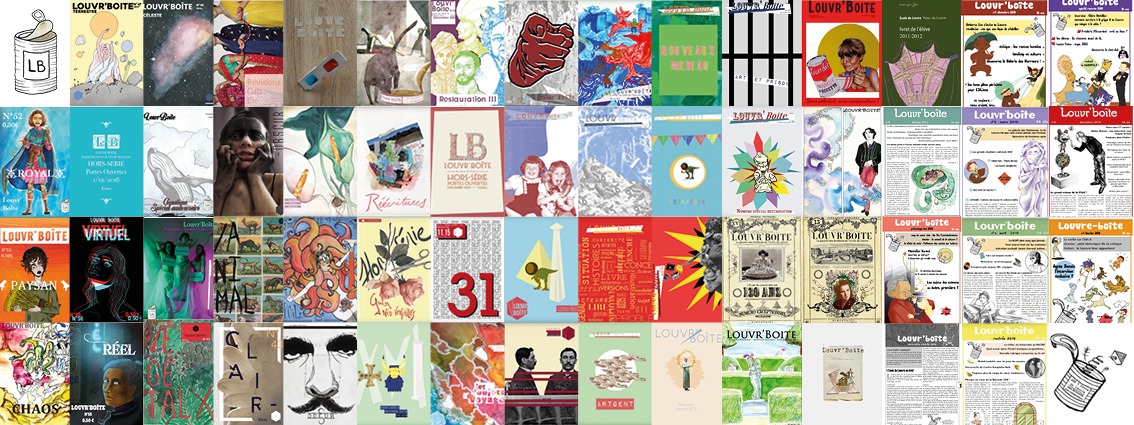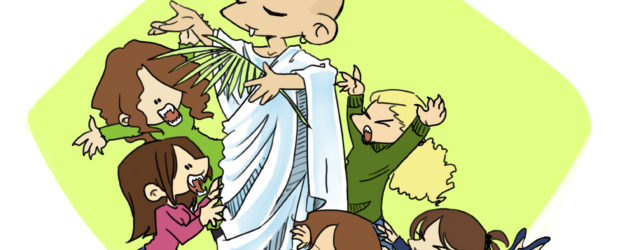À quel incroyable style vestimentaire peut-on te reconnaître en amphi ?
⭐️Un goût prononcé pour les plumes de volatiles et pour tout ce qui brille.
❤️À ta sublime paire de bottes, pour courir rejoindre ta place lorsque tu es en retard.
💣Du bien moulant, pour que se devine ton incroyable anatomie maniériste.
🔶Un peu chic et seyant, toujours avec une pointe de parfum derrière les oreilles.
🏳️Un peu ténébreux, pour cacher ton tendre petit cœur de poète.
❌Tu ne comptes pas le révéler car tu es toujours en avance d’une tendance…
Quand tu n’es pas en cours à l’école ou au musée :
⭐️Tu sors beaucoup avec tes amis (cinéma, restaurants, fêtes) même si tu devrais travailler.
❤️Tu te changes les idées en allant à la salle de sport ou en allant courir.
❌Une bonne série Netflix ou un jeu vidéo, un canapé confortable, ta nourriture préférée : que demander de plus ?
💣Tu organises des temps de travail en groupe pour être plus efficace.
🏳️Tu as un petit boulot pour payer tes factures et gagner en indépendance.
🔶Tu t’es inscrit(e) à des associations caritatives. Tu as des contraintes à respecter, toi.
Quel est ton mets préféré ?
🔶Du healthy, du fait maison, du gastronomique qui fait orgasmer les papilles.
❌N’importe quoi d’assez instagrammable pour mériter une photo.
💣Les légumes de cette bonne vieille Terre-mère.
❤️La soupe, pour devenir (encore plus) grand et fort.
🏳️Le professeur d’HGA qui t’a volé quinze minutes de ta pause déjeuner.
⭐️Le kebab, les sushis, le tacos cordon bleu, n’importe quoi qui se mange avec les mains… et entre potes.
La bibliothèque de l’école rouvre enfin :
❤️Bof. Tu t’en es passé toute l’année et tu as trouvé de nouvelles solutions pour t’adapter rapidement.
💣Tu t’y rends dès que tu peux, si possible à la première heure !
🏳️Tu ne peux pas y rester assis plus de deux minutes, ça énerve tout le monde mais tu viens quand même le faire.
❌Tu as encore du temps avant de devoir étudier la bibliographie. Les examens ne sont que dans deux mois…
🔶Prudent(e), tu réserves tes livres à l’avance sur Pléiades avant qu’ils ne soient couverts des miasmes du commun des mortels.
⭐️Tu empruntes tous les Arts de l’Inde de Anne Marie Loth pour faire flipper tes amis qui le voulaient aussi.
Quel est ton type de boisson préféré non alcoolisé :
💣Le chocolat chaud (si possible viennois…)
🔶Le thé. (avec un nuage de lait s’il vous plaît)
❤️Le café. (et plusieurs pour tenir toute la journée s’il vous plaît !)
⭐️Un soda, frais et pétillant.
🏳️Une bonne boisson énergétique, du type Red Bull, pour tenir les cours d’histoire des collections !
❌Un smoothie du turfu, avec les ingrédients les plus improbables !
En cours de TDO tu es plutôt du genre :
🏳️À poser des questions tout le temps (tu repères toutes les contradictions des artistes et des œuvres)
❤️À arriver toujours en avance car tu connais tous les raccourcis du musée (et avec ton petit tabouret bien pratique !).
💣À envoyer ton cours et tes notes dès que tes collègues en ont besoin.
⭐️À créer le groupe WhatsApp dès le début de l’année et à connaître tous les prénoms le premier.
🔶À effectuer le contact avec les chargés de TDO ou l’administration car tu es celui qui s’exprime le mieux.
❌À toujours prendre tes cours sur tablette, ordinateur ou téléphone (malgré les recommandations de Mme Lhoyer !).
Si tout était permis dans les musées tu…
💣Volerais cette statue si mal exposée que tu adores.
🏳️Taillerais en pièces l’impudent visiteur qui ose poser son doigt sur une œuvre.
❤️Camperais dans le Louvre.
🔶Déclarerais des poèmes aux visiteurs, aux arbres et aux cimaises.
⭐️Ferais un truc bien insolent au motif que c’est une performance artistique moderne.
❌Mais tout sera permis quand tu seras le directeur du Louvre.
Résultats :
(En cas d’égalité, référez-vous en bas de page)
💣Tu es Vishnou Varaha, le sanglier :
Tu es la personne de la situation, qui sait déployer son élégant mufle en toute occasion utile. Toujours là pour jucher sur ton épaule la Déesse-Terre (ou tes potes bourrés, ça arrive aussi), tu restes toujours lucide. Tout le monde reconnaît ton incroyable capacité d’initiative et de résistance à toute épreuve. Tes capacités aquatiques sont également hautement appréciées lorsqu’il s’agit de repêcher un camarade au moral un peu en berne. Le sérieux de ton organisation et de ta musculature nous sont quotidiennement d’un grand secours. Continue comme ça (et n’oublie pas d’essuyer ces restes de chocolat viennois de tes jolies défenses).
🏳️Tu es Vishnou Narasimha, l’homme-lion :
Un petit démon du style cartel manquant, livre indisponible, salle de TDO fermée ? Te voilà prêt à l’étriper. Impulsif, ton côté justicier peut vite s’enflammer et tu défends bec et ongle les causes qui te tiennent à cœur. Tu es parfois la maman de tes petits camarades dans le fond, une vraie shakti. Enfin, on te dit facilement susceptible, mais la vérité, c’est que sans toi, il manquerait un peu d’animation en amphi. On entend ta voix porter sur plusieurs rangs et tout le monde sait que ce n’est pas Brahma qui récite les Veda…
🔶Tu es Rama, le noble prince hindou avatar de Vishnou :
Tu es une personne distinguée, charmante mais parfois un peu distante. Le raffinement est ton art de vivre et tu te complais à cultiver ta différence par rapport au commun des mortels. Cependant lorsque tes intérêts ou ceux de tes proches sont menacés, tu n’hésites pas à détruire quelques démons et à jouer à l’Indiana Jones. Hanuman t’envoie des bisous !
⭐️Tu es Krishna, l’enfant-Vishnou qui ne sait pas arrêter son char :
Tu jongles entre un côté facétieux et imprudent, désirant vivre ta vie de jeune adulte pleinement, et un besoin de grandir et de t’assagir car tu sens ton côté divin te rappeler à l’ordre. Mais pour l’heure, à l’école, tu fais des bêtises. Avec le temps et tes diplômes en poche, tu découvriras enfin ton plein potentiel d’individu brillant et tu pourras enfin conduire ton char dans la direction la plus noble (mais passe quand même ton permis avant).
❤️Tu es Vamana, le Vishnou nain aux bottes de sept lieues :
Sous des aspects parfois chétifs, tu caches bien ton jeu. Sitôt ton pacte avec le démon Bali passé, tu te transformes en une personne dynamique, résistante et surtout rusée. Plus adaptable qu’une armoire Ikea, tu trouves toujours une solution de sortie, même pour les dissertations en trois parties. Enfin pour contrer les grèves de métro, c’est toi qu’il nous faut ! Le souffle divin t’anime dès qu’il s’agit de parcourir Paris.
❌Tu es Kalkî, le Vishnou du turfu :
Chill et sans prise de tête, tu ne te préoccupes pas du futur, allongé sur ton pouf Ananta. Pourtant, tu es notre prophète visionnaire dans de nombreux domaines ! Tu laisses la vie couler sur toi comme l’Océan originel en attendant de t’éveiller pleinement à ton potentiel divin. Il est difficile de te cerner mais nous sentons déjà ton originalité rayonner. Tu es promu à de grandes choses, #leretourdevishnou
En cas d’égalité :
Si vous ne vous retrouvez pas dans les avatars de Vishnou, c’est peut-être qu’un Shiva se cache en vous… Seriez-vous Harihara, une rareté des plus originales ?
Marie et Cassandre, vos dévoués Vishnou et Shiva… .