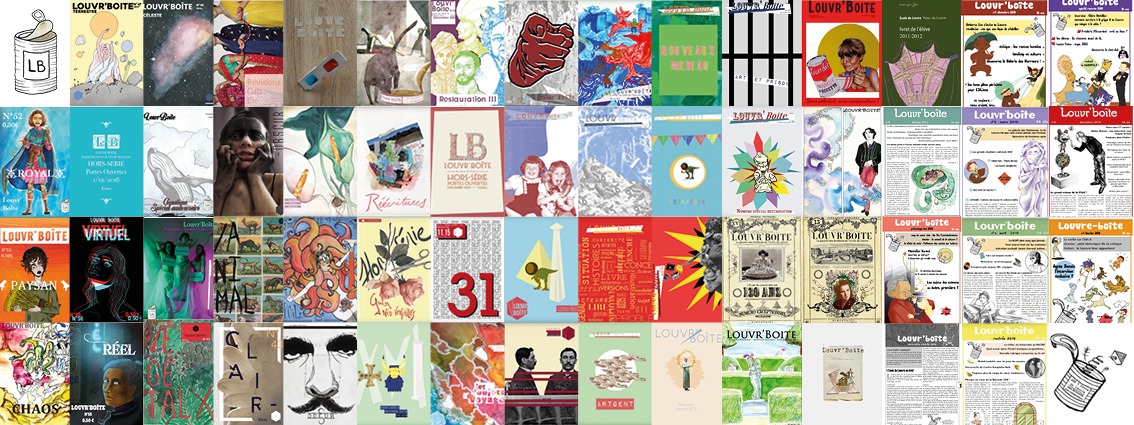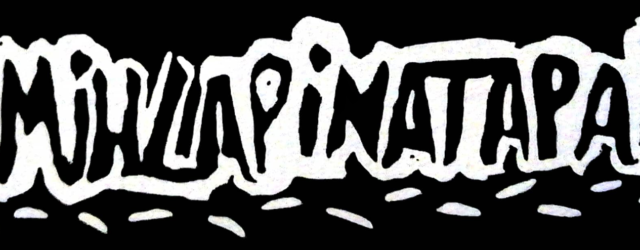Ce numéro Création méritait une petite incursion du côté du langage. Il m’offre l’occasion de parler de l’inédit, de l’inattendu, du bizarrement pensé : des mots intraduisibles. Il existe en effet une kyrielle de noms, verbes ou adjectifs sans équivalents en français. Ces termes aussi étranges qu’étrangers nous prouvent que quelques lettres peuvent faire émerger tout un monde de représentations mentales. À chaque mot, c’est un pan inconnu d’un nouvel imaginaire collectif qui se dévoile, avec parfois de belles surprises conceptuelles. Place à un petit top !
1) Les moustaches en albanais
Plutôt big (moustache en guidon) ou glemb (à pointes effilées) ? La moustache constitue en Albanie un véritable art traditionnel ! Un petite incursion internet vous prouve que même le roi d’Albanie Zog Ier soignait particulièrement sa holl (ou moustache fine), c’est dire… Une belle vingtaine de mots lui sont rattachés, tels varur (la moustache tombante), madh (la moustache bien fournie), ou encore kacadre (la moustache aux pointes retroussées).
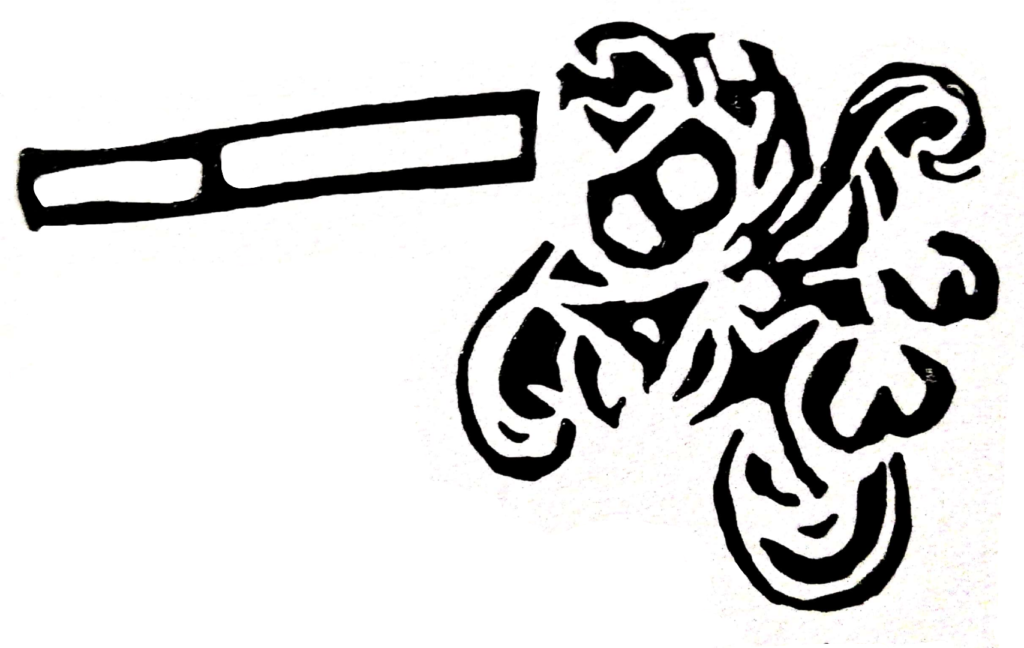
2) La sprezzatura italienne
Groupies de Baldassare Castiglione, bonsoir ! La sprezzatura, c’est cet art de la nonchalance feinte, du parfait naturel, de la flatterie courtisane qui semble s’ignorer, théorisée par ce monsieur, diplomate, nonce du pape et ami de Raphaël, dans son ouvrage Le livre du courtisan. Les artistes de la Renaissance eux-mêmes s’attachaient fortement à ce principe : d’après les Vies de Vasari, Michel-Ange aurait brûlé certains dessins de jeunesse afin de cacher le labeur cumulé de ses années d’apprentissage.
3) Mamihlapinatapai
Mamihlapinatapai est tiré du yagan de la Terre de Feu (comprendre : d’un dialecte amérindien dont les locuteurs résident dans l’archipel à l’extrême sud de l’Amérique du Sud, divisé entre le Chili et l’Argentine). Le terme a été repris dans le Guinness Book de 1994 comme le mot le plus succinct, et désigne l’état de deux personnes qui s’envisagent et attendent chacune que l’autre fasse le premier pas, sans qu’aucune des deux n’ose elle-même le poser. Personne ne vous en voudra de ne pas connaître le yagan, car il ne subsiste aujourd’hui dans le monde plus qu’une seule locutrice de cette langue, Cristina Calderón, une situation à tel point exceptionnelle que l’UNESCO a déclaré la dame de 93 ans “trésor humain vivant” en 2009.

4) Bakwe, ou la cigarette philippine
Les Philippines connaissent une fois par an ce que l’on appelle la saison des pluies (aka varsha en hindi). Mais comment faire alors pour s’en griller une si le ciel n’est pas très clément ? Le kapampangan, langue parlée dans une île de cet État, a la solution : bakwe. Bakwe, c’est l’art de fumer sa cigarette avec le bout allumé dans la bouche, afin de se réchauffer un peu le palais, et de profiter d’un petit plaisir pas totalement trempé…
5) Shibui, ou la contemplation de la salade de fruits
Comment résumer un sentiment esthétique empreint de suranné comparable au goût d’un kaki pas encore tout à fait mûr qui engourdit la langue ? Prenez l’adjectif shibui. Le kanji pour l’écrire signifie “astringent”, et se retrouve notamment dans le mot “grimace”. Shibumi est le nom commun dérivé de shibui, et désigne le fait d’avoir un sens esthétique posé et affirmé, avec pourquoi pas un côté un peu vieux jeu, acide ou suranné. Le terme se rattache parfaitement à l’esthétique wabi-sabi, qui promeut une beauté simple et rustique, pas forcément dénuée d’imperfections.

6) La marche en shona
Pour une raison que mes recherches n’ont pas pu élucider, il existe une petite dizaine de verbes pour désigner en shona, langue parlée principalement au Zimbabwe, le fait de marcher ! Que vous préfériez marcher à petits pas (tabvuk), avec une robe très courte (pushuk), pieds nus (dowor) ou même en tenue d’Adam (shwitair), il y a des verbes pour tous les goûts !
7- Le café suédois
Les confinements nous ont révélé que les cafés et bars constituaient en France de véritables institutions sociales, mais nous sommes de petits joueurs comparés aux Suédois ! Fika désigne en effet tout spécialement pour eux la pause café accompagnée de sucreries que l’on prend avec ses amis, et qui constitue un vrai rituel social… Le café est dans ce pays une telle institution qu’il a donné naissance à tout un champ lexical, avec des verbes comme tretar (comprendre : se servir son café pour la troisième fois dans la même tasse). Moins de convivialité chez nos amis finnois, qui ont tout de même un mot désignant spécifiquement le fait de se soûler tout seul chez soi en caleçon (alias kalsarikännit).
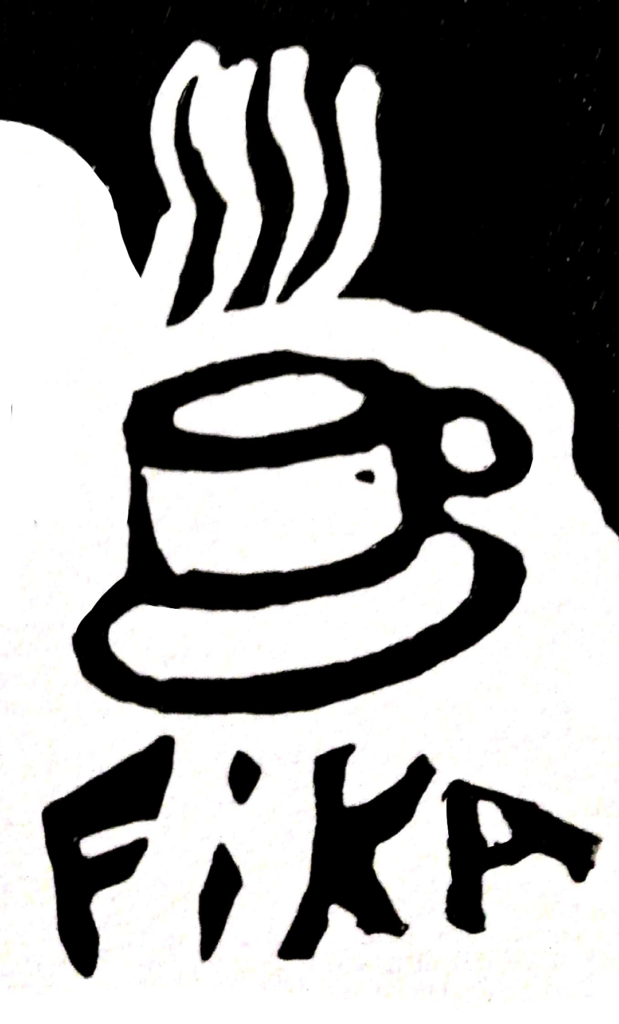
Pour partir à la rencontre d’autres mots inconnus mais incroyables, jetez un œil à la petite pépite nommée Les mots qui nous manquent, écrite par Yolande Zauberman et Paulina Mikol Spiechowicz (Ed. Calmann-Lévy).