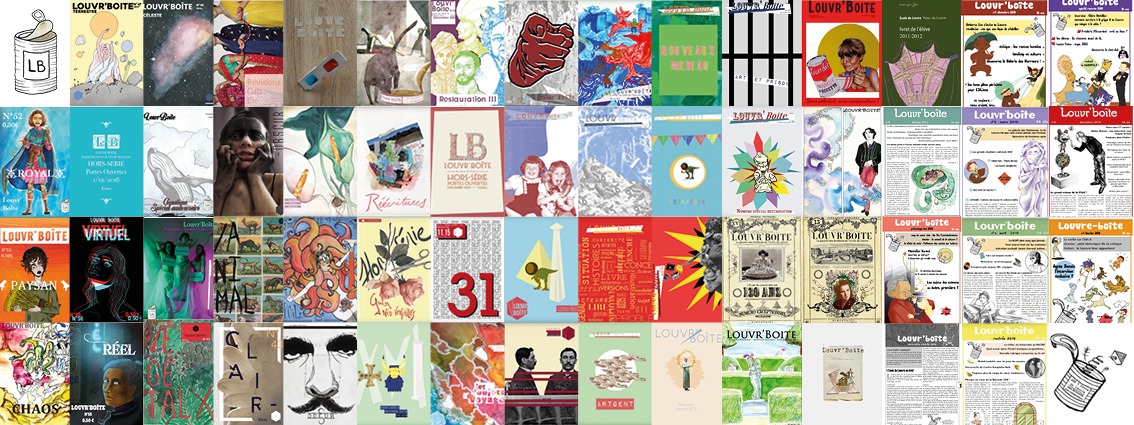Paul Perrin est actuellement conservateur des peintures au musée d’Orsay, et ce depuis juillet 2014. Il a été plusieurs fois stagiaire dans des musées, en France, mais aussi à l’étranger comme à New York ou Chicago. Il a également été guide-conférencier au château de Versailles, ainsi que chargé de TDO à l’École du Louvre dans le domaine du XIXe siècle.
Avant cela, il est passé par les deux premiers cycles de l’École du Louvre et par le concours de l’INP. Il apparaît comme un conservateur assez jeune (de 30 ans) et moderne dans les médias et sur les réseaux sociaux.
Son parcours :
Tristan Fourmy : Pour commencer, qu’avez-vous fait avant l’École du Louvre ?
Paul Perrin : J’ai déménagé plusieurs fois quand j’étais jeune. J’ai été au lycée Le Corbusier à Poissy, et ai passé un bac Littéraire option art plastique.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de suivre vos études dans l’histoire de l’art ?
Depuis longtemps je voulais travailler dans le domaine des films d’animation, de la bande dessinée ou de l’illustration, je m’étais inscrit dans une classe prépa après le bac pour passer le concours de l’école des Gobelins. J’ai découvert l’histoire de l’art assez tard, grâce à un excellent professeur d’art plastique, et ai décidé seulement en terminale de poursuivre dans ce domaine, non pas faire mais apprendre et comprendre. J’ai passé le test probatoire de l’école du Louvre et, comme je l’ai eu, j’ai renoncé à la classe préparatoire !