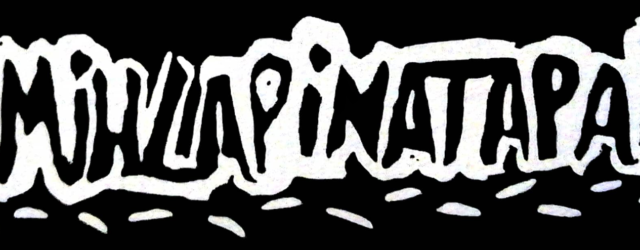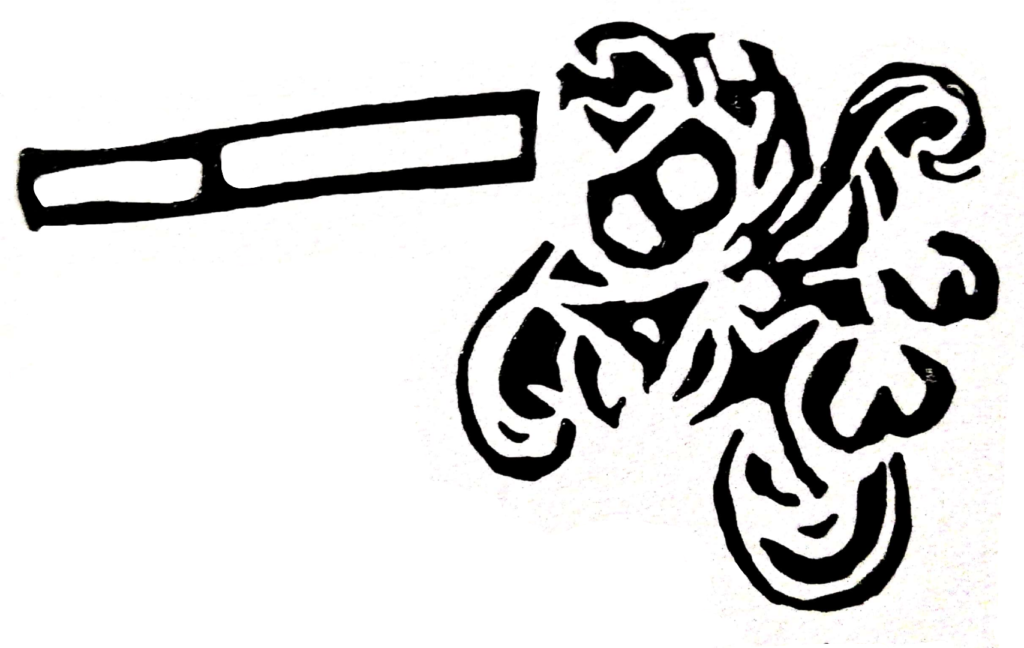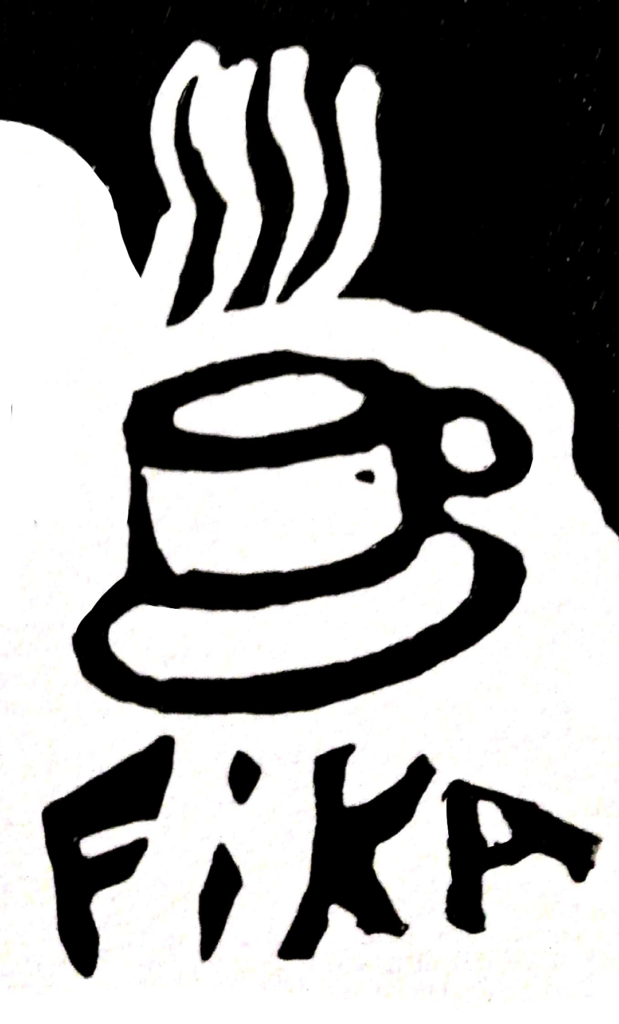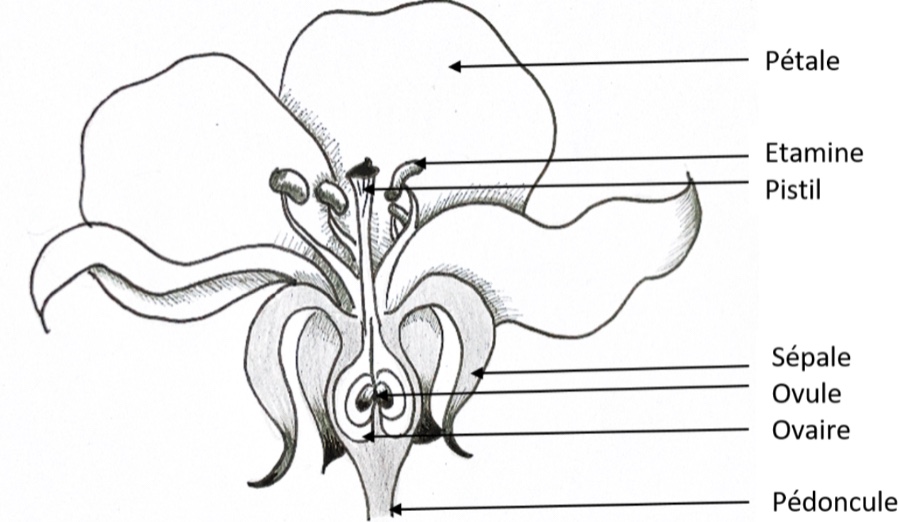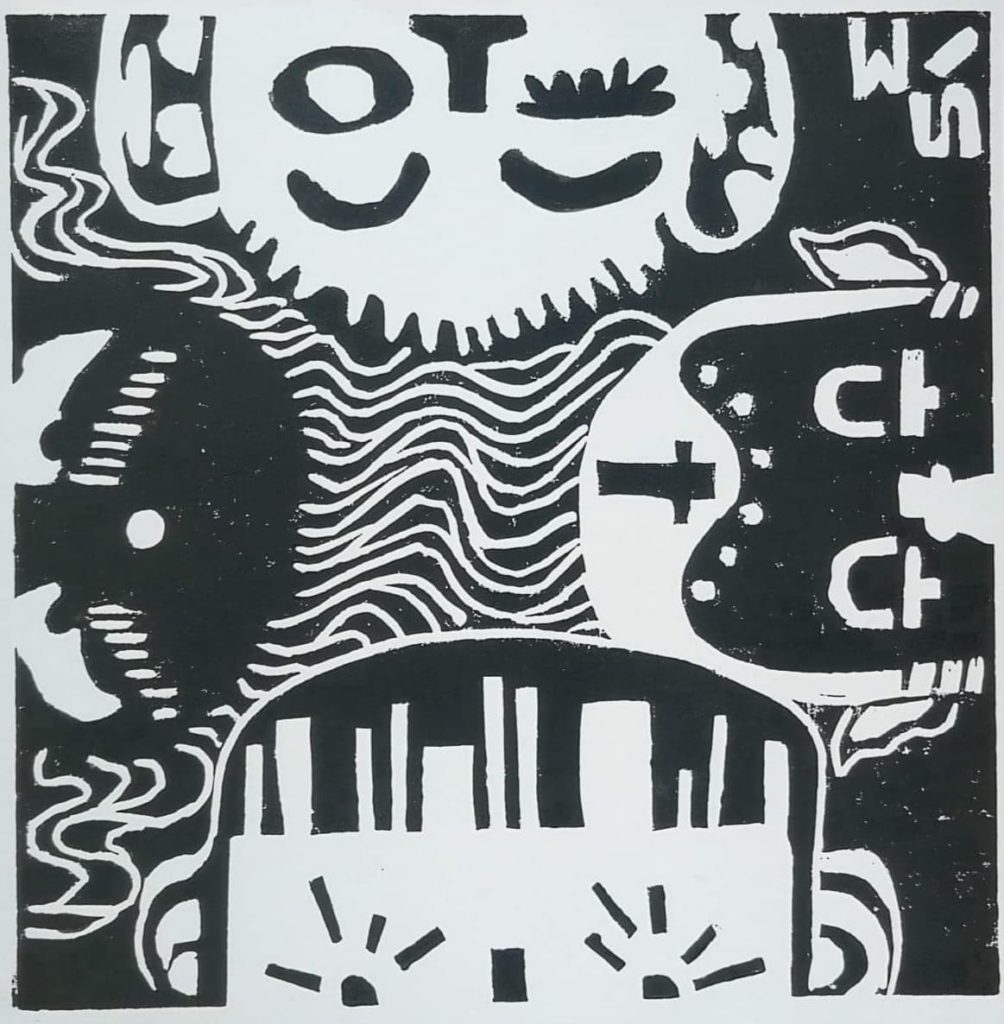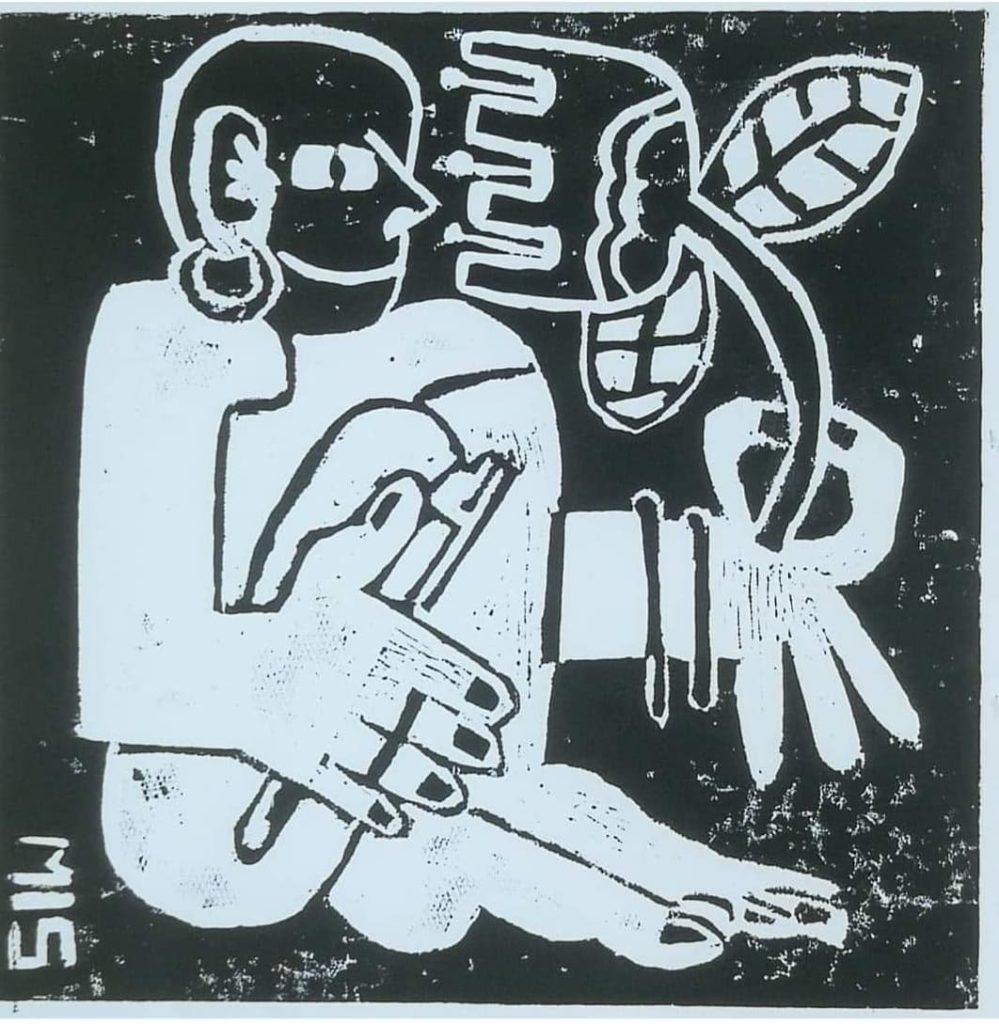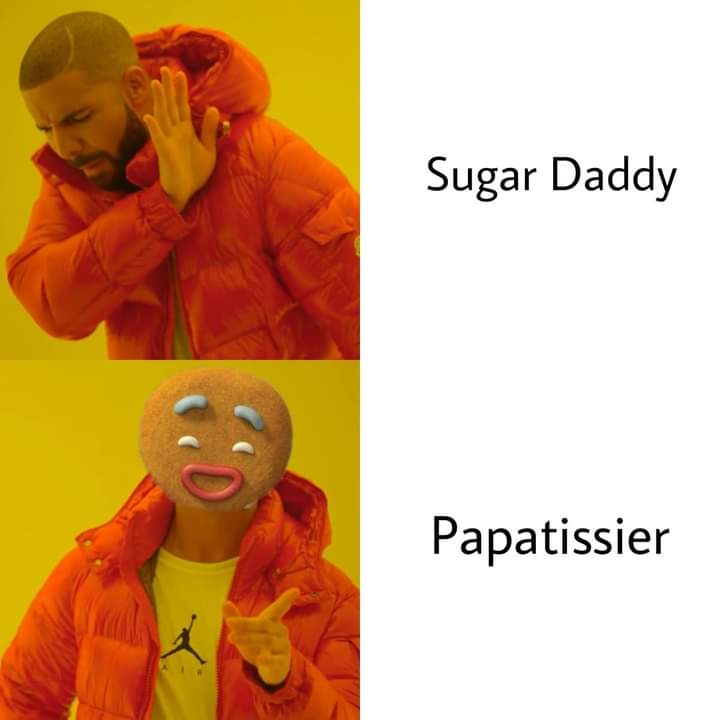Voici la suite de l’interview du club Art’Thémis. Merci au club féministe de l’école de nous avoir accordé cette interview enrichissante.
Question plus ciblée sur le féminisme : comment définiriez-vous votre engagement ?
C’est beaucoup de choses, un mouvement autour d’idées, de questionnements, d’élaboration de concepts, d’émulation. C’est aussi une lutte, contre un ennemi bien défini, le système patriarcal et ce qui en découle. C’est aussi un concept philosophique théorisé et historique. Tous.tes les militant.e.s vous diront que c’est un combat, le féminisme.
Comment définiriez-vous le féminisme ?
Le féminisme, c’est un mouvement qui a une très longue histoire maintenant et qui a eu tendance à s’accélérer au tournant de la Seconde Guerre mondiale et dans les années 1950 avec les premières vraies coalitions entre les femmes qui décident de théoriser le féminisme. Vous le savez peut-être mais ce mot est assez ancien et était presque exclusivement connoté péjorativement et les féministes se le sont réappropriées. Pour nous, il s’agit d’un ensemble de mouvements et d’idées qui visent à rétablir l’égalité totale et à tous les niveaux entre les femmes et les hommes. On vit dans une société patriarcale où les femmes sont largement dominées par des systèmes de valeurs et de symboles et qui les empêchent de jouir des mêmes privilèges que l’homme (blanc, cisgenre, hétérosexuel). Le féminisme concerne toutes les femmes, qu’elles soient victimes de sexisme, de racisme, d’homophobie, de transphobie ou encore de classisme pour ne citer que ces discriminations. Nous avons une définition qui s’inscrit dans le mouvement intersectionnel tel que théorisé par Kimberlé Williams Crenshaw, qui remet en cause le monopole de la surreprésentation de certains groupes au sein du mouvement. Le féminisme, c’est toutes les femmes ! Il lutte contre le patriarcat, les VSS subies par les femmes et contre des dominations qui sont intériorisées dans notre société et qui justifient aussi des crimes coVamme la culture du viol par exemple. À terme c’est un mouvement, nous l’espérons, qui est appelé à disparaître (mais qui a certainement encore quelques milliers d’années devant lui !).
On remarque que tu utilises beaucoup le terme « domination », mais qu’est-ce que tu mets derrière ce terme ?
Ah oui, c’est très intéressant, il faut retirer le tabou de ce mot. La domination, c’est un fait sociologique : dans notre société, il y a une classe dominante et une classe dominée. Et même plusieurs. Dans le cas du patriarcat, les hommes dominent les personnes sexisées au même titre que les colons ont dominé les personnes racisées. Aujourd’hui par les systèmes de valeurs, de représentation, ou quand on sait que les femmes sont payées 18% de moins que les hommes par exemple, on voit que c’est un fait. Ce n’est pas une perception personnelle. Dans la rue, un homme est moins en danger qu’une femme statistiquement. C’est factuel, pas accusateur.
Comment a été perçue la création d’un nouveau club féministe au sein de l’école ?
Je crois que ça a été très bien perçu. Quand j’ai rencontré Tanguy, l’ancien président des clubs, il m’a dit que ça avait été voté à la majorité, donc ça a été très bien vu à ce niveau-là, par tout le monde. Il y en a qui avaient un peu peur que le club marche sur les plates-bandes de Mauvais Genre(s). Mais c’est un truc avec lequel je n’étais pas du tout d’accord. Parce qu’il n’y a jamais trop de militants. Même s’il y a des convergences avec Mauvais Genre(s), chacun a ses lignes de fond, nous nous battons pour une chose et Mauvais Genre(s) a ses propres combats . Nous c’est vraiment contre le système patriarcal et ce n’est peut-être pas son ennemi premier. Une très bonne réception aussi au niveau de l’administration. Madame Barbillon en a pas mal parlé aux masters, au gala, où elle a encouragé les élèves à participer. Les personnes femmes se sont reconnues dans ce qu’on prônait. Beaucoup de gens nous ont écrit pour nous remercier. Étant donné qu’on est à l’École du Louvre, qui est une école d’art, les mentalités sont beaucoup plus ouvertes à ce type de questions. On n’est pas à HEC ou en école de commerce où on en aurait vraiment bavé, de source sûre, les associations féministes de ces institutions en bavent un peu plus. Au niveau de la définition du féminisme, c’est compliqué et on a eu quelques appréhensions à ce niveau-là. On se réunit donc demain avec le bureau pour élaborer une définition claire de notre féminisme. Vous avez peut-être entendu parler de certaines controverses pour certains mouvements. Nous on reste vraiment dans quelque chose d’inclusif et d’intersectionnel.
Justement, le féminisme se rallie à d’autres combats, de par l’intersectionnalité comme tu l’as évoqué. Alors à quand des actions avec d’autres clubs ? Notamment Mauvais Genre(s) (le club LGBTQIA+ de l’Ecole du Louvre) ?
Alors on fait pas mal de choses avec d’autres clubs, parce que tous les clubs peuvent se reconnaître dans notre combat, le club féministe n’est pas le seul à pouvoir être féministe, tous les clubs peuvent être féministes. Et ça, ça permet de faire de nombreux projets… comme ENDOrun ! Mauvais genre(s), ça ne s’est pas encore fait, mais on est en novembre, on s’est créé en septembre, donc on a le temps de créer des choses ! En plus ce serait formidable, on est des milieux militants, on est donc souvent d’accord, du moins on se contredit peu ! On aimerait collaborer avec eux et elles, mais pour cela il est nécessaire qu’ils sachent ce que nous prônons.
D’où l’établissement de la liste de vos valeurs …
Oui, c’est ça ! Ce travail de définition est essentiel dans un milieu militant, et d’ailleurs c’est ce qu’on fait tout le temps, de la redéfinition, de l’approfondissement. C’est la partie réflexive et théorisation du mouvement, et je trouve ça super intéressant. Le féminisme est au cœur de notre époque, il est au cœur des débats, il est en train d’être défini, c’est une émulation qui est superbe !
Il est pluriel en plus, il y a différents mouvements.
Oui ! L’intersectionnalité vise justement à unifier ces mouvements qui se créent spontanément. C’est important de définir ses termes quand on est militant. C’est nécessaire pour les gens qui s’engagent ! L’intersectionnalité, peu de personnes connaissaient ce terme il y a un an, alors qu’il est aujourd’hui au cœur des débats.
Pour parler un peu d’art, pensez-vous qu’il y ait une différence entre l’art produit par les femmes et par les hommes ?
Alors non, pas du tout ! C’est une idée reçue qu’il y aurait un art féminin et masculin. Dire qu’il y aurait une différence entre les deux reviendrait à alimenter des discours sexistes qui créent une dualité entre les hommes et les femmes et justifier certaines réflexions sur les femmes, qui auraient un art plus sensible, plus romantique, alors qu’absolument pas ! Il n’y a pas de différence innée entre les hommes et les femmes, c’est une différence de personne, de comment elle a évolué dans la société, et de vécu. Le genre de la personne n’intervient pas dedans. Après, le fait que dans le système actuel, quelqu’un ait grandi en tant que femme et ait été soumis à des dominations et des oppressions peut influencer son art. Mais c’est une personne dans une société et pas son genre en tant que femme. Tout comme la notion de male gaze qui était à l’origine utilisée dans le cinéma, théorisée par Iris Brey. Elle décrit comment un homme va percevoir et représenter des personnages féminins à l’écran. Mais encore une fois ça n’est pas le genre, c’est comment quelqu’un qui a évolué en tant qu’homme dans une position de domination dans la société va se représenter les femmes. Il faut distinguer l’inné de l’acquis en fait. Notre jeu du Jeu de piste était sur ce sujet, justement, déconstruire l’idée qu’il y ait un art féminin et un art masculin. Nous avions présenté une iconographie similaire, peinte par un homme et par une femme, pour montrer que d’un premier coup d’œil on ne peut pas distinguer si ça a été créé par une femme ou par un homme. Je crois que c’était Judith et Holopherne l’un par le Caravage et l’autre par Artemisia Gentileschi. Celui de Gentileschi est beaucoup plus gore, il se fait décapiter, le sang gicle de partout, c’est une vraie scène de boucherie, alors que celui du Caravage est bien plus doux dans sa lumière, bien plus délicat.
Est-ce que tu pourrais nous parler d’une femme qui selon toi mérite plus de reconnaissance dans le milieu de l’art ?
La première qui me vient à l’esprit c’est une artiste contemporaine qui s’appelle Jane Campion, je ne sais pas si vous connaissez, c’est une très grande réalisatrice avec un cinéma particulier, qui vient déconstruire l’idée du regard de la femme qui serait plus sensible. Son cinéma est gore, elle n’hésite pas à incarner ce genre de cinéma. Alors qu’il y a vingt ans, on n’imaginait pas qu’une femme fasse ce genre de cinéma dans lequel par exemple il y a un personnage qui se fait couper les jambes. En plus c’est un cinéma ultra féministe. Il met en scène des personnages féminins qui viennent déranger la société. Ce sont des femmes indépendantes, qui sont, en plus, souvent artistes, qu’elle met en scène dans ses films. Comme La leçon de piano, mettant en scène une femme artiste amoureuse de son piano. Et le film In the Cut. C’est une femme indépendante, écrivaine. Elle montre des scènes assez violentes et des milieux controversés, comme celui de la prostitution, en luttant contre le male gaze parce qu’elle met en scène des personnages féminins et montre des lieux, sans apposer un regard moralisateur. C’est un cinéma assez cru, très féministe, qui mériterait beaucoup plus de visibilité.
Pensez vous que l’art puisse servir le combat féministe ?
Bien sûr ! L’art est un moyen d’expression privilégié des humains, cela permet de vivre son combat de façon sensible, différemment que par le militantisme. C’est d’ailleurs pour ça que, pendant des années, dans l’art et le cinéma, quand on n’avait que la visibilité des hommes, qui représentaient le monde à travers leur regard et représentaient les femmes, on avait l’impression que c’était la réalité. Pendant des années, notre connaissance de l’art a été exclusivement celle produite par les hommes. L’art sert complètement au combat et permet d’exprimer des choses crues de façon très belle. On voit l’influence de l’art sur le monde. Frida Kahlo quand elle a commencé à représenter son corps et à se réapproprier cette représentation, ça a marqué un tournant. Quand on regarde Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig, c’est un film féministe, choc, ça a motivé beaucoup de femmes à retrouver leur liberté, à se réapproprier leur corps. Ce sont des actes forts qui permettent aux gens de modifier leur mentalité et de représenter un monde qui n’est pas uniquement perçu par les hommes.
Nous avons deux questions peut-être un peu plus complexes. Pensez-vous que certaines personnes soient plus légitimes de se revendiquer féministes ?
Euh… Ah c’est dur ! Vous me piégez ! Ce que je dis peut être retenu contre moi ! *Rire* C’est très complexe la question de la légitimité dans le militantisme. Je vais partir d’un exemple qui m’est personnel. Pour la marche des fiertés, le copain cisgenre, hétéro d’une amie, se demandait s’il était légitime de venir, sachant qu’il n’a pas de revendication LGBTQIA+. Mais pourtant il voulait soutenir ces idées et ce mouvement, et participer à ce combat, mais ne se sentait pas légitime. Et vous voyez comme c’est complexe, car d’une part nous n’allons pas l’interdire de venir marcher, sinon ce serait négatif. Finalement, il n’y est pas allé car il avait peur de déranger les personnes concernées. C’est un choix que je trouve mature et respectueux. Mais la question se pose forcément. Nous on voudrait que tout le monde soit féministe, c’est-à-dire, veuille une égalité totale. Toutes les classes, tous les genres ! Mais pour la question du militantisme c’est plus compliqué. Nous nous sommes demandé à Art-Thémis : si un homme veut travailler au bureau et être secrétaire général, que ferions-nous? D’un côté s’il est féministe, bien sûr ! Nous voulons que les hommes soient féministes. Mais d’un autre côté ça reste un homme, qui n’a pas vécu les oppressions et dominations qu’on a vécues. Il n’a pas cette expérience, de vivre en tant que personne sexisée. Alors est-ce qu’il est légitime de venir défendre ce qu’il ne connaît pas et n’expérimentera jamais ? C’est pour ça que je pense que les hommes peuvent plutôt être désignés par le terme « proféministes », c’est-à-dire partageant les valeurs féministes mais sans être des représentants du mouvement. Mais c’est clair que si une personne se proclame féministe, elle est légitime ! Mais participer activement c’est sujet à débat. Il y a aussi une question de représentation: qui représente le mouvement féministe ? Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça m’intéresse…
C’est la même question pour les espaces non-mixtes …
Alors moi je suis pour clairement ! Mais oui c’est le même débat.
Donc, là où est le débat et la complexité, c’est de savoir qui on met sur le devant de la scène pour porter l’engagement militant ? Les militants sont tous légitimes, quelle que soit la sphère militante. C’est ceux qui sont les chefs de file, entre guillemets, qui posent question, c’est bien ça ?
Exactement !
Personnellement cette question, elle m’est venue en me disant : je suis féministe, mais est ce que j’ai la légitimité de débarquer auprès du club et de dire « salut je suis un homme cisgenre blanc, je suis féministe !»
Encore une fois, tout le monde est légitime, mais comme tu dis, c’est la question de la représentation. Si on met un homme dans les postes à responsabilités, à l’échelle d’Art-Thémis secrétaire, ce serait bizarre. D’ailleurs les filles d’Art-Thémis étaient contre. Nous les excluons du bureau, mais ça ne veut pas dire que nous ne voulons pas qu’ils s’engagent, loin de là ! Tout le monde est légitime de se revendiquer féministe mais les hommes c’est compliqué…
Autre question. Pensez-vous qu’il y a des degrés de féminisme ?
Vous me posez des questions difficiles ! *Rire* Des degrés de féminisme… je dirais que plutôt que des degrés de féminisme, il y a des degrés d’engagement. C’est plutôt ça la question, à quel degré, à quelle intensité on va s’engager dans un combat. Une personne peut se dire féministe, sans pour autant être engagée dans un milieu associatif ou dans des institutions, mais juste dans ses valeurs, prôner le féminisme. Et c’est le cas de beaucoup de personnes, qui partagent les valeurs du féminisme, mais qui au quotidien ne font pas des collages, n’approfondissent pas les théories, ne vont pas se lancer dans des études de genre. Le degré c’est plutôt l’engagement. Mais à partir du moment où tu veux une égalité totale, que tu sois engagé 24h sur 24 ou pas du tout, le féminisme est le même.
Pour revenir à ce qu’on disait : ce qui est intéressant, c’est que je comprends que l’égalité c’est l’objectif final, mais que pour l’atteindre on a besoin de renverser le système. On ne peut pas être égalitaires tout de suite ?
Alors oui, pour moi il y a une nécessité là. Une nécessité de la radicalité. Vous vous souvenez quand Alice Coffin a déclaré refuser de lire de la littérature écrite par les hommes. Elle s’est faite lyncher. Moi j’étais d’accord, parce que, à un moment il faut une radicalité avant d’aboutir à une égalité comme tu dis. Donc c’est vrai que ce choix est radical, ça peut paraître extrême, mais c’est un acte militant fort puisque les femmes ont été invisibilisées depuis la Préhistoire si ce n’est des exceptions. Donc oui, avant d’opérer et d’aboutir à une égalité totale, il faut un renversement des valeurs. Passer par des réunions non-mixtes par exemple, c’est nécessaire pour théoriser et avancer nos combats entre nous, concernées. Il faut des exemples radicaux. Je ne sais pas si ça vous satisfait…
Si si ! c’est parfait ! On va tâcher de retranscrire ce que tu dis sans déformer ton propos !
C’est ça qui est subtil quand on parle féminisme ou militantisme, c’est de ne pas heurter et avoir l’air manichéen, tout en montrant que l’engagement est nécessaire. C’est difficile, même au quotidien. Il faut toujours faire attention aux termes qu’on emploie par exemple.
Encore une question : est-ce que vous avez l’impression de déranger l’ordre établi et finalement de venir mettre votre grain de sel ?
Mettre son grain de sel je trouve cela réducteur… Ce n’est pas un terme que je privilégierais. Déranger l’ordre établi… peut-être un peu, mais ce serait un peu malhonnête de le dire comme tel, dans la mesure où on a vraiment eu une très bonne réception, autant de la part des élèves que de l’administration. Donc les gens ont eu une réaction de surprise, mais une bonne surprise. Il y avait déjà eu des essais, et ce besoin de féminisme. Donc ce n’est pas perturber un ordre établi, mais apporter quelque chose qui de manière informelle était attendu. Et c’est aussi parce qu’on est dans une école globalement ouverte d’esprit. On nous laisse organiser des conférences sur les thèmes qu’on veut par exemple.
Oui c’est compréhensible. Maintenant on peut peut-être en venir au mot de la fin. À toi la parole !
Pour moi le truc le plus important c’est de faire passer le message qu’il n’y a pas que le club féministe qui puisse l’être. C’est un terme qui fait encore peur, il y a quelques années, peu de gens se revendiquaient féministes sans avoir peur que ça ait une connotation négative. Ce qu’on veut à Art-Thémis, c’est démocratiser le féminisme, à notre échelle, mener une action pédagogique, répondre aux questions : qu’est-ce que c’est ? Comment je peux l’être ? Nous voulons montrer que tout le monde peut être féministe, que ça n’est pas difficile, que c’est juste un apprentissage à l’échelle de tous. Et aussi prôner l’ouverture d’esprit !
D’accord, merci ! Est-ce que toi tu aurais une question pour les gens, ou est ce que tu voudrais que les gens se posent une question ?
Ce serait bien de se demander: est-ce que je subis des dominations intériorisées ? J’inciterais les gens à faire un travail de déconstruction et à se demander: ce que vous pensez, est-ce votre réception personnelle, ou est-ce que c’est influencé par ce qu’on vous a dit ? En fait se poser de simples questions sur ses valeurs, et savoir simplement si on est en accord avec nos actes.
Très bien… merci ! Je crois bien qu’on a fini… Oui on a fini … TADAMMM !
Alors voilà cher lecteur ! C’est fini ! Eh oui… déjà ! Merci de nous avoir accompagné dans cette rencontre avec Art-Thémis et Clara ! Merci d’être resté avec nous jusqu’ici. On espère que ça vous a intéressé, que vous vous êtes vous-mêmes posé plein de questions et que vous avez réfléchi à votre avis à chacune de nos questions. Si vous avez, vous aussi, des questions à poser à Art-Thémis, n’hésitez pas à les contacter ! Sachez aussi qu’un pôle sensibilisation reste à votre écoute si vous êtes victime ou témoin de harcèlement et/ou de violences sexistes et sexuelles, il vous suffit de les contacter avec l’adresse mail infosensi.arthemis@gmail.com, votre anonymat étant garanti !
Et n’oubliez pas. À la demande de Clara, posez-vous la question : est-ce que mes actes sont en accord avec mes valeurs ? Sur ce, on vous laisse à votre introspection, après cette longue mais passionnante interview, nous on se sépare pour aller manger… un bon repas salé !
Les réseaux de l’association:
Instagram: art_Thémis.edl
Facebook: Art-Thémis: club féministe de l’Ecole du Louvre
Adrien & Noémie