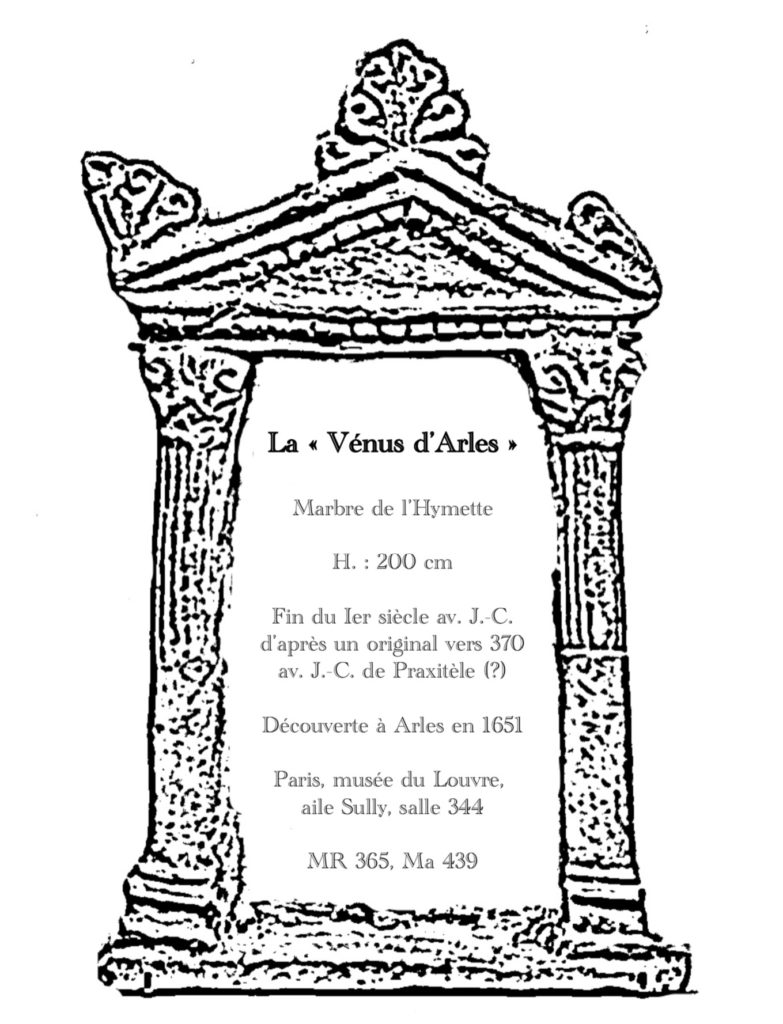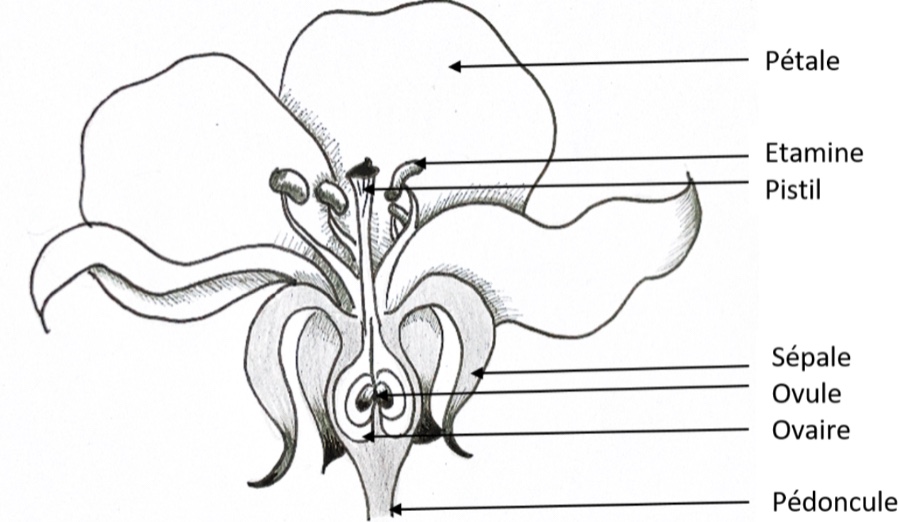Voici un article exclusif de notre site, une sorte de hors-série. Le Louvr’Boite avait déjà interviewer Anaïs Ripoll il y a deux ans à l’occasion de son premier roman, le Secret de l’École du Louvre. À l’occasion de cet entretien nous organisons en parallèle un concours sur Instagram afin de gagner un exemplaire de son nouveau romain Réparer l’affront.
Pour débuter cette interview, pourriez-vous vous nous décrire votre parcours à l’Ecole du Louvre et nous parler de votre premier livre, Le Secret de l’Ecole du Louvre ?
Je suis rentrée à l’Ecole du Louvre en 2006. J’avais 19 ans et j’ai suivi la spécialité «Art du XXe siècle ». J’ai commencé à écrire le manuscrit du Secret de l’Ecole du Louvre en 1ère année, en le voyant comme une parodie du Da Vinci Code car l’histoire met en scène quatre étudiantes de l’Ecole du Louvre menant une enquête à la suite du vol d’un tableau du musée. Je l’avais écrit pour faire rire mes copines, immortaliser nos « délires », les surnoms que l’on donnait à nos professeurs et aux garçons de l’amphithéâtre par exemple. Je n’avais jamais pensé à en faire un véritable ouvrage.
Dans votre dernier roman « Réparer l’affront », quel est l’origine du roman, l’idée qui vous a poussé à le commencer ?
J’ai repris et terminé Le Secret de l’Ecole du Louvre presque dix ans après avoir écrit le manuscrit à l’Ecole. Comme je l’avais écrit pour des raisons personnelles et que je ne le voyais pas comme un véritable roman, je l’avais un peu abandonné. Je ne me considérais pas écrivain et quand je l’ai terminé et autopublié en 2019, j’ai pensé que je ne réécrirais probablement plus jamais.
Pourtant pendant le confinement de l’année dernière, j’ai été inspirée par la situation et j’ai écrit un second roman intitulé Tant que le jour se lèvera, centré sur un couple de toulousain partant vivre dans les Pyrénées, en autonomie dans la nature. Avoir retrouvé de l’inspiration m’a étonnée moi-même. On me demandait souvent « À quand le deuxième ? » mais je ne pensais pas vraiment réécrire un jour. D’ailleurs même après ce deuxième roman, je me suis dit encore une fois que parcours d’écrivain allait s’arrêter là car je n’avais pas d’idée pour un autre livre. Je ne me mettais pas non plus de pression pour trouver de nouvelles idées, j’avais aussi ma vie professionnelle à côté.
Cependant, l’année dernière, mon travail m’a fourni une nouvelle source d’inspiration. Je suis commissaire-priseur dans une étude d’huissiers de justice. J’ai été assez fascinée par le pouvoir d’investigation des huissiers qui ont la charge de retrouver certaines personnes pour récupérer des dettes et faire exécuter des jugements. Ils peuvent donc enquêter pour les retrouver. De cette pensée, j’ai brodé un fil en imaginant ce qui se passerait si ce pouvoir se retrouvait entre les mains de quelqu’un d’un peu fragile ou obsessionnel. La personne pourrait alors utiliser cette capacité d’enquête pour retrouver la trace de quelqu’un qu’elle aurait perdu de vue.
Votre vie influence donc souvent vos histoires. Dans la dédicace de votre livre, vous mentionnez vos amies qui vous auraient aidées à créer le personnage d’Elodie, la meilleure amie. Y a-t-il d’autres détails comme celui-ci dans votre histoire ?
« Est-ce que c’est vrai ? » est souvent la première question que me posent les lecteurs. Ce livre peut être assez choquant car l’héroïne est ambivalente, très attachante mais à la limite de la folie, ce qui la rend donc un peu effrayante. Des personnes de mon entourage se sont donc demandées quelle était la part de vérité dans cette histoire un peu sombre.
Je me suis inspirée de ma seule histoire d’amour de vacances, il y a maintenant plus de dix ans. Le personnage de Robin existe donc bel et bien, même si le prénom a bien évidemment été modifié. Je n’ai plus aucun contact avec lui, je ne sais pas ce qu’il est devenu et il ne sait sûrement pas que ce livre a été écrit. Cependant, contrairement à cette histoire, je ne l’ai pas retrouvé dix ans après notre rencontre.
J’ai aussi voulu rendre hommage à une amie en particulier, Lisa, qui m’a inspirée le rôle d’Elodie, la meilleure amie rigolote et parfois un peu pathétique. J’ai porté un regard tendre sur toutes nos années de galères lorsque nous avions la vingtaine, avec nos histoires compliquées avec les garçons ou les aventures sans lendemain. J’ai même ressorti des journaux intimes de cette époque, donc d’il y a dix ans. Cela a été un vrai travail d’introspection et certaines anecdotes et textes du livre sont réels. Je sais que Lisa a été touchée de relire et redécouvrir ces moments-là.
En tant que lecteur, on peut avoir l’impression que la seule personne réellement décrite et introspecté est Jeanne, l’héroïne et que les personnages qui gravitent autour d’elle sont assez flous et indiscernables dans leur personnalité. Est-ce un choix fait pour accentuer sa personnalité égocentrique ?
Le choix a été fait non pas d’un narrateur omniscient mais d’un narrateur avec un point de vue unique, celui de l’héroïne ce qui limite les points de vue. On voit les autres personnages à travers ses yeux. Jeanne est très torturée et son évolution psychologique est particulière, il est donc difficile de se faire une idée précise du caractère de ces autres personnages, surtout que je voulais également que les personnages gravitant autour d’elle soient ambivalents, que l’on ne sache pas véritablement quoi penser d’eux. Dans la première partie par exemple, on s’attache à Robin, puis finalement on se demande pourquoi l’héroïne n’arrive pas à l’oublier alors que c’est un homme ordinaire, ou au contraire on le trouve très attachant. Je voulais que rien ne soit tranché, que chacun ait son opinion sur qui est le bon et le méchant de l’histoire, ou même qui est le plus décevant.
C’est également le cas pour la meilleure amie, on la voit vraiment à travers le regard de Jeanne. Parfois elle est très attachante, on la trouve loyale, on voit en elle une très bonne amie, et à d’autres moments elle est très pathétique, comme lorsqu’elle est prête à mettre le grappin sur n’importe quel homme. Elle est désespérée, donc on la trouve décevante, on trouve qu’elle rate un peu sa vie. C’est à chacun d’aimer ou non les personnages.
Comme vous l’avez dit précédemment, cette histoire est inspirée d’un amour de vacances, pouvez-vous nous en dire plus ? Pourquoi avoir choisi ce thème de l’amour à distance et de l’idéalisation ? Et enfin pourquoi l’avoir tourné dans une forme aussi torturée alors que le début nous laisse plus présager un roman « à l’eau de rose » ?
A mon avis, si cela n’avait été qu’une simple histoire d’amour, ce livre aurait été comme tous les autres et n’aurait eu aucun intérêt particulier, plus comme un roman de vacances à l’eau de rose effectivement. Il fallait qu’il se passe quelque chose, qu’il se noue un drame. Je me suis inspirée du livre Mort sur le Nil d’Agatha Christie, un auteur que j’affectionne beaucoup. Ce roman raconte l’histoire d’un triangle amoureux lors d’une lune de miel qui va tourner au drame. C’est mon roman préféré d’Agatha Christie.
C’est donc autour de ce thème récurrent et presque immortel du triangle amoureux que j’ai voulu travailler sur pourquoi et comment un amour de vacances aussi furtif avait pu prendre tant d’importance. De plus, cela m’est arrivée l’année dernière de rêver de ce garçon que j’avais rencontré plus jeune et que je n’avais plus vu depuis dix ans. Au réveil, cela m’a choquée de voir à quel point notre inconscient est capable de nous jouer des tours. Je me suis demandée pourquoi j’avais tout d’un coup rêvé de lui. C’est en relisant mes journaux intimes que je me suis rendue compte que ce garçon avait été important pour moi pendant très longtemps alors que notre histoire avait été très courte. C’est à partir de là que j’ai réalisé qu’il y avait sûrement quelque chose à travailler autour de ces amourettes de vacances qui peuvent nous marquer pendant longtemps.
L’héroïne passe parfois de la 3e personne du singulier à la deuxième personne du singulier lorsqu’elle pense à Robin. Est-ce pour montrer sa confusion ? Ses sentiments pour lui ? Le déni qu’elle met en place pour se protéger ?
A certains moments, Jeanne est tellement en colère qu’intérieurement elle s’adresse à lui. Et c’est une manière d’établir un dialogue qui n’a jamais eu lieu, d’évacuer une frustration, car ils ne sont jamais expliqués sur ce qui s’était passé.
Il y a peu de verbes de paroles et d’incises dans les dialogues. Est-ce un trait d’écriture récurrent dans vos romans ou est-ce particulier à celui-ci ?
Je crois que c’est plutôt personnel à celui-ci. J’en avais mis beaucoup dans mon premier roman quand j’étais très jeune et à la relecture j’ai trouvé ça un peu lourd. J’ai donc voulu alléger les dialogues.
L’héroïne a une évolution psychologique très forte. On la voit passer d’une jeune fille un peu naïve à une sorte d’obsession ou de folie. Pourquoi avoir poussé jusqu’à la limite cette évolution psychologique ?
Je pense que l’on a tous une Jeanne en nous et je voulais montrer qu’il y a une limite à ne pas franchir et elle l’a dépassée car elle est très orgueilleuse. Elle voulait réparer une blessure d’ego. On en vient même à se demander si elle a vraiment aimé Robin car finalement ils ne se connaissent pas. C’est un amour de vacances, un amour idéalisé. Et pourtant elle veut absolument le récupérer. On a l’impression qu’elle cherche plutôt à guérir quelque chose en elle. Je voulais que tout l’intérêt du roman, dans lequel il ne se passe finalement pas grand-chose, soit mis sur cette radicalisation de sa personnalité, de sa psychologie, de voir comment quelque chose qui n’a pas été traité ou évacué tout de suite peut laisser des séquelles et peut empirer. Cela pour cela que l’on passe d’une héroïne un peu naïve, amoureuse, à laquelle on peut facilement s’identifier, pour qu’à la fin on la déteste tellement elle est odieuse. Elle en vient à mépriser tous ces proches. Comme on est dans sa tête, on voit à quel point elle est méchante. C’est ce sur quoi j’ai voulu mettre l’accent dans ce roman.
Ca donne un tout autre ton au roman, il y a un moment, je ne saurais dire quand, on bascule vraiment, point de vue interne donne un sentiment de malaise car on est pas d’accord avec elle. Tout le long du roman, on est plutôt du côté de la copine, Élodie.
C’était inédit pour moi de me mettre dans la peau d’une méchante, même si le terme est assez réducteur, j’ai trouvé ça génial, un côté un peu machiavélique. Dans mon second roman, « tant que le jour se lèvera », c’est un roman très contemplatif, l’héroïne est une artiste, se poser des questions existentielles, c’est un couple qui survit dans la nature donc on est pas du tout sur des choses de ce niveau là. Et la d’avoir choisi volontairement d’être dans la peau d’un personnage que le lecteur va finalement détester, c’était vraiment une expérience super pour moi. Très intéressante. Mais je me rends bien compte que c’est un parti pris.
Mais c’est aussi ça qui fait l’originalité du livre. J’avais un autre question pour rebondir quand vous disiez qu’on à tous une Jeanne en nous, la toute fin du livre laisse présager que c‘ est pas vraiment la fin de l’histoire de Jeanne, est-ce que vous penser peut-être à une suite, juste dans votre tête, ce qui pourrait arriver avec ce nouveau contact.
C’est vrai que j’aime beaucoup les fins ouvertes, parce que à la fois il y a un goût d’inachevé qui fait « à zut ! ». À la fois énervant et excitant. Ça laisse la possibilité au lecteur d’imaginer ce qu’il veut. Et pk pas une suite, chacun est libre d’imaginer que mb l’arrosera serai arrosé et la méchante punie dans un futur proche ou lointain. Je voulais quand même aussi, sans spoiler mais une partie de la fin du roman est un procès. Et ca je voulais rendre à César ce qui est à César, c’est tiré d’un roman qui à reçu de nombreux prix, qui est sorti très récemment que j’ai adoré, Les Choses humaines de Karine Tuil. C’est un roman qui est tiré d’une histoire vraie, qui s’est déroulé aux États-Unis, d’un fait divers autour d’un viol et de la question autour du consentement. Une question très épineuse, repose sur la parole, contre la parole de l’autre. A quel point il n’y à pas de preuve, que c’est très compliqué. Cette affaire m’a intéressé et le livre que j’ai adoré, de se plonger dans un procès, un peu comme si on y était en direct. Avec des questions très directes posées et aussi le machiavélisme avec lequel parfois elles sont posées dans l’intention d’orienter la réponse. Et ça je voulais vraiment essayer de retranscrire quelque chose de similaire. Et montrer que Jeanne arrive tout le temps à rebondir, elle a réponse à tout, c’est insupportable. J’en dis pas plus. Le thème du procès m’intéressait beaucoup et celui de la victime qui est piégé, qui n’est pas forcément celle que l’on croit.
Cette fin personnellement, ça m’a donné l’impression que vous vouliez donner une idée de cercle sans fin. Comme vous dites c’est l’arroseur qui est arrosé mais surtout on à l’impression que tout le monde peut être dans le cas de Robin mais aussi celui de Jeanne, les deux à la fois sans s’en rendre compte.
Exactement. Quand à la fin, ce contact dont Jeanne n’a pas le moindre souvenir, qui ne l’a pas marqué revient en disant qu’il ne l’a jamais oublié. Elle est choquée, même effrayée en se disant « mais il est complètement cinglé, il m’a complètement idéalisé, on ne se connait pas ». Elle ne se rend pas compte qu’elle à eut exactement cette attitude envers Robin, qu’elle a nourrit elle-même un fantasme. On peut donc être chacun l’un de ces personnages, on a tous eu des fixettes, des idéalisations, des fantasmes sur des histoires qui n’ont jamais été faites. On est probablement aussi le fantasme de quelqu’un, on n’en sait rien. Pour l’anecdote, car c’est très drôle qui m’a inspiré cela, j’ai un ex, vous allez croire que j’ai beaucoup d’ex (rires), avec qui j’étais sortie à la fac avant de faire l’École du Louvre, j’étais très jeune, dix-huit ans, l’histoire d’une soirée. Il m’a recontacté l’été où j’écrivais ce roman, donc douze ans après, véridique, en me disant « tu as été odieuse, tu m’as bloqué de partout » À l’époque je l’avais bloqué de tout mes réseaux et il m’a retrouvé sur Instagram. Il m’a dit « je ne t’ai jamais oublié, tu représente tout ce que j’imagine de mieux ». J’ai eu très peur, j’ai failli le bloquer de nouveau mais je me suis dit « non, ne soit pas odieuse, il faut arrêter de bloquer les gens ». Je me suis dit que le mec était complètement fou, on ne se connait pas, on ne s’est pas vu depuis douze ans. Il me connaît à travers l’image que je donne via les réseaux sociaux. Et le fait que tout cela se confronte, mon roman et le fait que mon ex insignifiant me recontacte à ce moment-là, c’est là que je me suis dit, on peut nourrir une obsession mais en être l’objet.
Que diriez-vous aux écrivains en herbe qui sommeillent sur les bancs de l’école ? Des personnes qui comme vous on écrit quelque chose mais n’ont pas confiance ou l’idée même que cela puisse devenir sérieux ?
C’est assez magique d’avoir une espèce de secret qui dort dans son ordinateur, on à l’impression d’avoir une histoire qui n’existe que dans notre imaginaire, une relation fusionnelle et unique avec l’histoire que l’on crée, que l’on invente. On est les seuls à savoir qu’il existe donc il y a une sorte de beauté mais je crois qu’il ne faut jamais s’arrêter à la peur du regard de l’autre et trouver le bon moment. Moi cela a été dix ans après pour Le secret de l’école du Louvre, de mon point de vue, cela ne valait pas la peine d’être lui, ne tenait pas debout. Je me suis dis, on n’a qu’un vie et aujourd’hui avec l’autoédition, tout le monde peut publier son livre et l’avoir dans les mains. C’est quand même une chance. Il y a quelque chose de magique de tenir son rêve dans les mains et de se dire que tous peuvent potentiellement le lire. C’est presque publier son journal intime même si c’est une fiction. C’est vous qui inventez l’histoire et les personnages. Entre guillemet, vous vous mettez à poil, pardonnez-moi l’expression. *rire*. C’est comme sauter dans le vide si on aime les sensations fortes. Je pense qu’il faut oser, au bon moment même s’il faut plusieurs années de maturité, il faut y aller, s’auto-publier pour le plaisir.
Je voulais juste rebondir sur une dernière chose, il y avait un fil rouge dans ce roman, qui était les réseau sociaux
Voulez-vous faire une critique, un message de votre propre expérience ou peut-être juste de la société en générale ?
Au départ, ils s’ajoutent sur Facebook, ensuite Messenger. Puis chacun fait croire à l’autre pendant des années qu’il va très bien, que leur vie est géniale via Facebook. Ensuite, symboliquement, Jeanne décide de tourner la page définitivement en le supprimant de Facebook mais elle finit par le chercher sur les réseaux pour le retrouver. Dans la période du procès, les médias s’emparent de l’affaire, chacun donne son avis en polluant l’affaire. Et cela m’a été beaucoup inspiré des féminicide actuelle, Delphine Jubillar, toute ses affaires non élucidés de meurtres horrible, de viol. Chacun devient enquêteur, donne son avis pour une raison, voir même crée des pages dédiées à l’enquête. C’est une chose qui me choque, je me suis dit que d’aborder le sujet de A à Z, la manipulation par les réseaux pouvait être intéressant. J’en ai été victime à la fois, et tout le monde à mon avis dans notre société actuelle, c’est très dangereux de jouer avec son image parce que Jeanne se retrouve piégé car Robin va croire pendant des années qu’elle s’est parfaitement remise de leur histoire alors qu’elle est au fond du trou. Je l’ai vécu quand j’avais la vingtaine mais je pense qu’on est nombreux à l’avoir fait. Donner l’image qui n’est pas la bonne via les réseaux, surtout quand on va mal.
Est-ce que vous pensez que la relation entre Jeanne et Robin, s’il n’y avait pas eu ce prisme des réseaux sociaux, mentir à l’autre, que finalement la relation aurait pu fonctionner ou qu’en fin de compte, Jeanne aurait tout autant idéalisé Robin.
C’est difficile à dire car cela reviendrait à imaginer l’histoire sans ces réseaux, comme à l’époque de nos parents. Peut-être que la relation aurait été plus saine, qu’il se serait parler de manière plus honnête et transparente. Il est difficile de réécrire l’histoire, je ne saurais dire. Jeanne à ses névroses. À un certain moment du roman où elle dit « Sauve-moi », elle attend d’être sauvée. Robin aurait pu, mais lui-même avait ses propres problèmes, que c’est peu probable. J’avais une question à vous poser, en tant que lectrice, qu’est ce qu’on ressent pour un personnage aussi ambivalent que Robin ?
Je n’ai pas apprécié Robin au début, parce que j’avais l’impression qu’il avait un comportement assez mauvais envers Jeanne. Au fur et à mesure du roman, notamment vers la dernière partie, j’ai eu plus d’empathie envers lui par rapport à l’attitude de Jeanne envers lui. (Éloïse)
Je l’ai trouvé dragueur à leur première rencontre. J’ai toujours eu beaucoup d’empathie pour lui car il n’avait pas une situation facile. Il effaçait sa personnalité pour son père, ce que je trouve assez fort. Je comprenais son besoin de mettre de la distance, de faire la fête, donc cela ne m’a pas gêné. Je trouvais Jeanne trop dans la retenu de ses sentiments, il n’y avait pas assez de communication donc je ne blâmais pas non plus Robin pour cela. Finalement, de toute manière, on a de plus en plus d’empathie pour lui, à mesure que le temps passe pour Robin. Le pauvre se retrouve pris dans quelque chose qu’il n’a pas demandé. (Cassandre)
J’ai essayé que l’on aime Robin dès le début parce qu’il est charmeur, un peu fou fou etc, on sent qu’il est sincère et qu’il à un vrai coup de coeur pour elle.
C’est un homme bien.
Exact, ce n’est pas un baratineur, sauf qu’il est lâche. Il est jeune et immature, ne sait pas quoi faire de sa peau. C’est du vécu, quand on à la vingtaine, les mecs ils veulent pas s’attacher quand ils ont le coups de cœur. Ils veulent s’amuser, on a toutes vécu cela. Ce qui est hyper décevant car on sens qu’il y a un potentiel mais qui n’est pas assumé de l’autre côté. On le blâme donc pour sa lâcheté, mais quand elle le retrouve dix ans plus tard, on se dit que le type n’a toujours pas évolué, il a les mêmes démons alors pourquoi elle s’acharne sur le même mec qui pourrait être n’importe quel autre ? Jeanne veut plus régler une question d’orgueil que de véritablement le reconquérir à tout prix.
Oui parce qu’on voit que ce n’est pas un homme parfait, mais qu’il n’est pas mauvais non plus.
Mais il est tout de même très facilement manipulable. On sent qu’il est perdu car il suffit que Jeanne débarque dans sa vie et trois jours après il a foutu sa vie en l’air. Il est très faible et comme elle c’est un dragon, forcément cela explose.
Auriez-vous un mot pour achever cet entretien, une remarque ?
Je ne sais pas, peut-être qu’un jour le vrai Robin lira cette interview et se reconnaîtra. Rassurez-vous, je ne suis pas obsessionnelle et je suis très sympathique *rire*.
Merci beaucoup de vous avoir accordé votre temps et au revoir.
Cassandre et Éloïse